
Licenciement économique : quand le juge dépasse les chiffres pour juger les difficultés
Les points clés à retenir sur l’appréciation des difficultés économiques
- Le juge n’est pas lié par les seuls indicateurs légaux : il peut retenir tout élément de nature à démontrer la réalité des difficultés, même en dehors des critères de l’article L.1233-3 du Code du travail.
- Une approche globale prime sur la lecture comptable : la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes n’est pas indispensable si d’autres signes objectifs révèlent une dégradation économique sérieuse.
- Les difficultés doivent être réelles, sérieuses et durables : un recul ponctuel ou conjoncturel ne suffit pas, la situation doit présenter une tendance structurelle.
- Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain : il évalue librement les éléments de preuve produits par l’employeur pour vérifier la réalité du motif économique.
- Cette jurisprudence offre une lecture pragmatique du droit du travail : elle renforce la cohérence entre logique économique et exigence juridique, en admettant des preuves diversifiées pour justifier un licenciement économique.
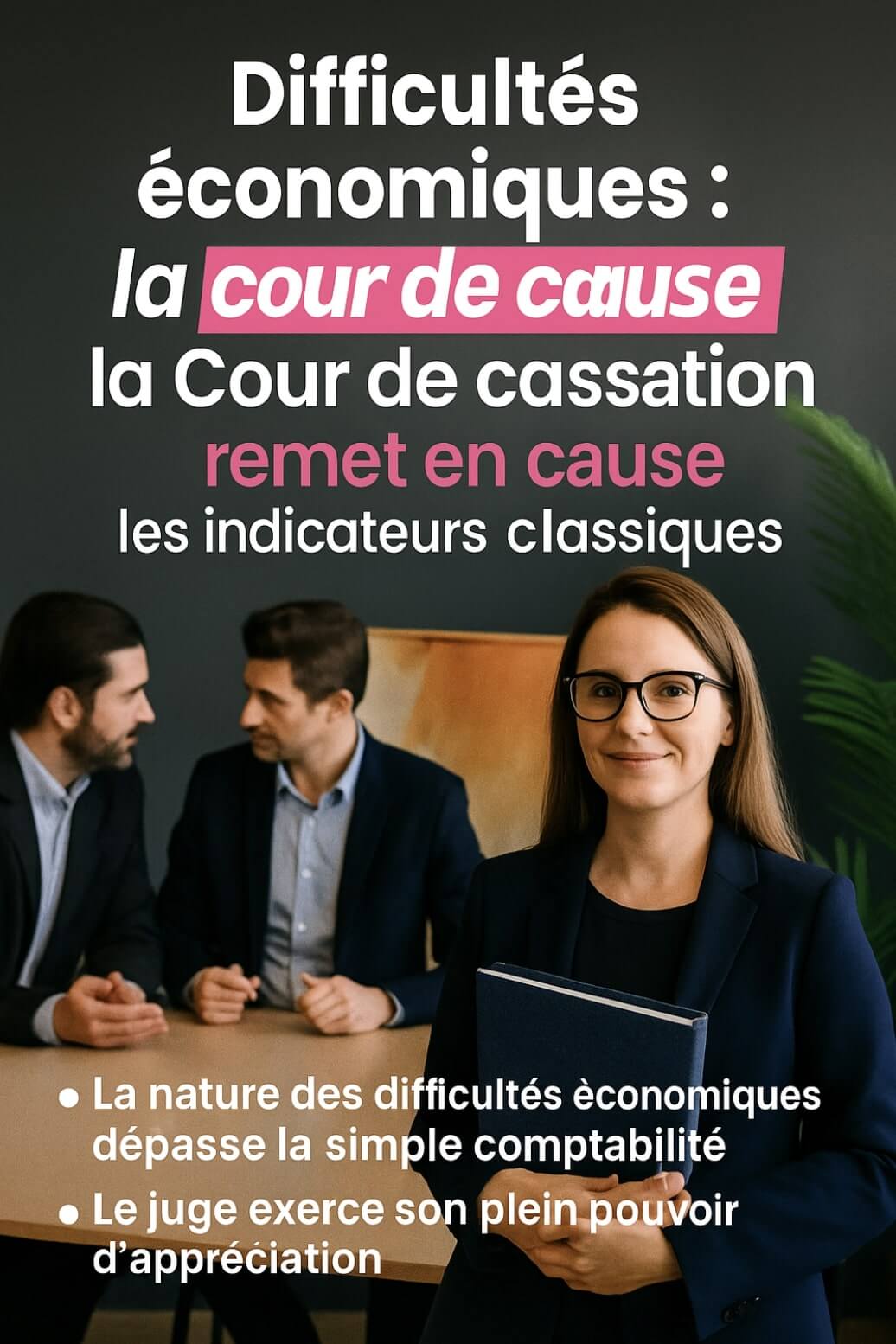
Une lecture souple de la notion de difficultés économiques
Par un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (n° 24-12.213), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme une tendance jurisprudentielle déjà amorcée : le juge n’est pas strictement lié aux indicateurs économiques énumérés par l’article L.1233-3 du Code du travail pour apprécier la réalité du motif économique d’un licenciement.
Il peut, dans le cadre de son pouvoir souverain, retenir tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, dès lors qu’il permet d’en établir le caractère réel, sérieux et durable.
Cette décision, passée relativement inaperçue, mérite pourtant une attention particulière. Elle éclaire la frontière mouvante entre le cadre légal fixé par la loi Travail du 8 août 2016 et la liberté d’appréciation du juge du fond.
Le cadre légal : des critères objectifs mais non exhaustifs
Depuis la réforme de 2016, l’article L.1233-3 du Code du travail définit précisément les motifs économiques pouvant justifier un licenciement.
Les difficultés économiques doivent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants :
- une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant une période donnée (un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, deux trimestres pour celles de 11 à 49, etc.) ;
- des pertes d’exploitation ;
- une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;
- ou encore tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Ce dernier critère, souvent relégué au second plan, introduit une marge d’interprétation importante. Il permet au juge de s’extraire du strict carcan comptable pour apprécier la situation économique dans sa globalité : contexte sanitaire, perte d’un client majeur, restructuration interne ou charges devenues disproportionnées peuvent ainsi être pris en compte.
Les faits : une entreprise confrontée à une baisse d’activité multifactorielle
Dans l’affaire commentée, une salariée licenciée pour motif économique contestait la réalité des difficultés invoquées par son employeur, la société Alu Glace.
La cour d’appel de Bourges (22 décembre 2023) avait constaté que, si la société ne démontrait pas une baisse continue du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres, elle subissait néanmoins une détérioration significative de ses résultats.
Les juges du fond avaient relevé :
- une baisse du chiffre d’affaires du second semestre 2020 de plus de 10 % par rapport à la même période de 2019 ;
- un recul du résultat d’exploitation d’environ 30 % sur l’exercice 2020 ;
- et ce, malgré une réduction des effectifs et une diminution des loyers consentie par les bailleurs.
Ils avaient en outre observé la persistance de la dégradation au premier semestre 2021, excluant le caractère purement conjoncturel des difficultés.
Pour la salariée, ces éléments ne suffisaient pas : selon elle, la loi impose que les difficultés soient démontrées par les indicateurs listés, à savoir une baisse durable des commandes ou du chiffre d’affaires, ou des pertes d’exploitation effectives.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : le juge du fond, rappelle-t-elle, n’est pas tenu de s’enfermer dans les indicateurs légaux, dès lors qu’il fonde sa décision sur des éléments objectifs, cohérents et vérifiables.
Le pouvoir d’appréciation souverain du juge
La haute juridiction réaffirme ici un principe bien connu mais parfois sous-estimé : le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve.
Autrement dit, la loi encadre la démonstration des difficultés, mais elle ne restreint pas la liberté d’analyse du juge.
Ainsi, la Cour de cassation valide l’approche de la cour d’appel qui s’était fondée sur :
- l’évolution globale des résultats financiers (et non la seule baisse des ventes) ;
- les efforts de réduction des charges opérés par l’entreprise ;
- et la durabilité des difficultés constatées.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante :
- dès 1997, la Cour avait jugé qu’un licenciement économique suppose des difficultés réelles, sérieuses et durables ;
- en 2023, elle avait précisé que le juge peut se référer à tout élément comptable ou factuel démontrant une dégradation économique, même si l’un des indicateurs légaux n’est pas formellement caractérisé.
L’arrêt du 17 septembre 2025 confirme donc une interprétation pragmatique de la loi : les indicateurs économiques servent de balises, non de frontières.

Une approche plus économique que comptable
L’enjeu de cette décision dépasse la simple question des preuves. Elle traduit une vision économique et dynamique du droit du travail.
Les difficultés d’une entreprise ne se lisent pas toujours dans ses bilans : certaines tensions de trésorerie ou déséquilibres structurels peuvent précéder la chute des indicateurs.
Le juge, dans cette logique, se place dans une approche préventive : il admet que des signaux faibles (recul du résultat, baisse ponctuelle d’activité, perte d’un client stratégique) puissent justifier des mesures d’anticipation, y compris un licenciement économique.
Cette souplesse favorise une sécurité juridique pour l’employeur, qui n’est plus obligé d’attendre une situation déficitaire ou une baisse durable du chiffre d’affaires pour agir. Mais elle exige, en contrepartie, une justification rigoureuse et une documentation complète du contexte économique.
Quelles implications pratiques pour les entreprises ?
Les employeurs doivent retenir plusieurs enseignements :
- La preuve doit être multi-critères.
Il ne suffit pas de produire un extrait de bilan ou un tableau de chiffre d’affaires. Les juges attendent une vision d’ensemble : évolution des marges, des coûts fixes, de la trésorerie, et des décisions de gestion prises pour corriger la tendance. - La notion de durabilité reste centrale.
Une baisse conjoncturelle ou un simple effet de saison ne suffisent pas. L’entreprise doit démontrer que les difficultés persistent dans le temps ou qu’elles résultent d’une situation structurelle (marché en contraction, hausse durable des charges, perte d’un contrat clé…). - La cohérence du discours de l’employeur est déterminante.
En cas de contestation, la cohérence entre les documents produits (comptes, prévisionnels, échanges internes, décisions de gestion) sera examinée avec attention. - La prudence reste de mise sur la temporalité.
L’article L.1233-3 précise que les difficultés doivent être appréciées à la date du licenciement. Les éléments postérieurs peuvent toutefois éclairer la situation, comme l’a admis la Cour de cassation dans cette affaire.
Un équilibre entre souplesse judiciaire et exigence de preuve
Cette jurisprudence illustre la dualité du droit du licenciement économique :
- la sécurité juridique pour les entreprises, qui peuvent agir avant que la situation ne devienne critique ;
- la protection du salarié, garantie par l’exigence de preuves tangibles et de motivations sérieuses.
Le juge se positionne ainsi comme arbitre de la réalité économique, non comme simple contrôleur de conformité comptable. Il ne s’agit plus d’opposer rigueur juridique et logique économique, mais de concilier les deux au service d’un objectif commun : la sincérité du motif.
En résumé
L’arrêt du 17 septembre 2025 consacre une approche pragmatique du licenciement pour motif économique.
S’il confirme l’importance des indicateurs légaux, il en relativise la portée en rappelant que toute preuve objective de difficultés réelles, sérieuses et durables peut être prise en compte.
Cette lecture plus souple de l’article L.1233-3 du Code du travail s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit du travail aux réalités économiques.
Pour les entreprises, elle ouvre la voie à une anticipation raisonnée des difficultés.
Pour les salariés, elle préserve le contrôle du juge, garant d’une utilisation sincère et proportionnée du motif économique.
Ainsi, le droit du travail, loin d’être figé, continue d’évoluer à la frontière du droit et de l’économie — un équilibre subtil que le juge, une fois encore, contribue à préserver.
Pour accompagner les entreprises dans l’interprétation de ces évolutions jurisprudentielles, les cabinets d’avocats en droit du travail à Versailles jouent un rôle essentiel en matière de conseil stratégique et de sécurisation des procédures.
Foire aux questions sur les difficultés économiques et le licenciement
1. Qu’entend-on exactement par « difficultés économiques » selon le Code du travail ?
La notion de difficultés économiques est définie à l’article L.1233-3 du Code du travail.
Elle recouvre plusieurs situations objectives pouvant justifier un licenciement pour motif économique, parmi lesquelles :
- une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur une période donnée ;
- des pertes d’exploitation répétées ;
- une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;
- ou encore tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Ce dernier point, souvent méconnu, permet au juge d’élargir son analyse au-delà des simples indicateurs chiffrés. Il peut ainsi tenir compte d’événements extérieurs (crise sanitaire, hausse brutale du coût des matières premières, perte d’un client stratégique) ou de données structurelles affectant durablement l’équilibre économique de l’entreprise.
En somme, les difficultés économiques ne se limitent pas à un déficit comptable : elles englobent tout contexte démontrant une atteinte sérieuse et durable à la santé financière de l’entreprise.
2. Le juge est-il obligé de se fonder sur les indicateurs économiques légaux ?
Non. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-12.213), rappelle que le juge n’est pas tenu de se limiter aux indicateurs listés par la loi.
S’il constate que les éléments produits (comptes annuels, bilans intermédiaires, trésorerie, plan de charge, pertes de clients, etc.) permettent d’établir la réalité et la gravité des difficultés, il peut les retenir même s’ils ne figurent pas expressément dans les critères légaux.
Cette souplesse vise à éviter une lecture purement arithmétique du droit du licenciement économique. Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation et analyse la situation dans son ensemble, y compris des éléments contextuels tels que :
- une restructuration nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ;
- un déséquilibre structurel entre coûts fixes et activité réelle ;
- ou une chute temporaire de rentabilité annonciatrice d’un risque durable.
3. Quelles preuves l’employeur doit-il fournir pour justifier un licenciement économique ?
L’employeur doit être en mesure de démontrer par des éléments objectifs, vérifiables et datés que l’entreprise traverse une période de tension financière réelle.
Les documents attendus par le juge peuvent comprendre :
- les bilans et comptes de résultats des années précédentes ;
- des tableaux comparatifs du chiffre d’affaires ou des marges ;
- les rapports de gestion et prévisionnels d’activité ;
- les décisions de gestion prises pour limiter les pertes (réduction des charges, non-remplacement des départs, etc.).
L’important est de démontrer une logique économique cohérente : le licenciement ne doit pas être une décision d’opportunité, mais une mesure nécessaire pour assurer la survie ou la compétitivité de l’entreprise.
Dans l’arrêt Alu Glace, la Cour a jugé suffisants des éléments combinés — baisse de chiffre d’affaires de 10 %, recul du résultat d’exploitation de 30 %, diminution des loyers — pour établir la réalité des difficultés.
4. Une baisse ponctuelle du chiffre d’affaires suffit-elle à justifier un licenciement économique ?
Pas nécessairement. La baisse doit être significative, réelle et durable.
L’article L.1233-3 du Code du travail impose une baisse sur plusieurs trimestres consécutifs selon la taille de l’entreprise (un à quatre trimestres). Une fluctuation isolée ou conjoncturelle ne suffit donc pas.
Cependant, la jurisprudence admet que d’autres critères peuvent corroborer une situation économique dégradée, même en l’absence d’une baisse prolongée :
- une érosion du résultat d’exploitation,
- une augmentation des dettes fournisseurs ou sociales,
- une trésorerie insuffisante pour couvrir les charges à venir.
Autrement dit, la baisse du chiffre d’affaires n’est qu’un indicateur parmi d’autres : c’est la cohérence globale du diagnostic économique qui prime.
5. Quelles précautions un employeur doit-il prendre avant d’invoquer des difficultés économiques ?
Avant toute mesure de licenciement, l’employeur doit s’assurer que la situation économique remplit bien les conditions légales et jurisprudentielles. Plusieurs précautions sont recommandées :
- Documenter chaque élément : conserver tous les justificatifs comptables, échanges avec les partenaires financiers et décisions internes.
- Anticiper le dialogue social : informer et consulter les représentants du personnel, le cas échéant.
- Envisager des alternatives : aménagement du temps de travail, mobilité interne, réduction d’effectifs temporaires, avant d’envisager un licenciement.
- Motiver précisément la lettre de licenciement : la cause doit être économique, sérieuse et objectivement vérifiable à la date de la décision.
Enfin, il est conseillé de faire auditer la situation par un avocat en droit du travail dans les Yvelines ou un expert-comptable avant toute procédure, afin de s’assurer que les difficultés sont réelles et durables, et que la documentation produite sera suffisante en cas de contentieux.

Notre annuaire recense les meilleurs avocats en droit du travail à Versailles, sélectionnés pour leur expertise et leur engagement auprès des salariés, employeurs et cadres dirigeants.
Accédez à des profils vérifiés, des avis clients authentiques et trouvez rapidement le professionnel qu’il vous faut pour défendre vos droits ou sécuriser vos démarches juridiques.
Vous souhaitez rejoindre l'annuaire ?
Vous souhaitez rejoindre notre annuaire des meilleurs avocats à Versailles ? Publiez gratuitement votre cabinet et gagnez en visibilité locale dès aujourd’hui.